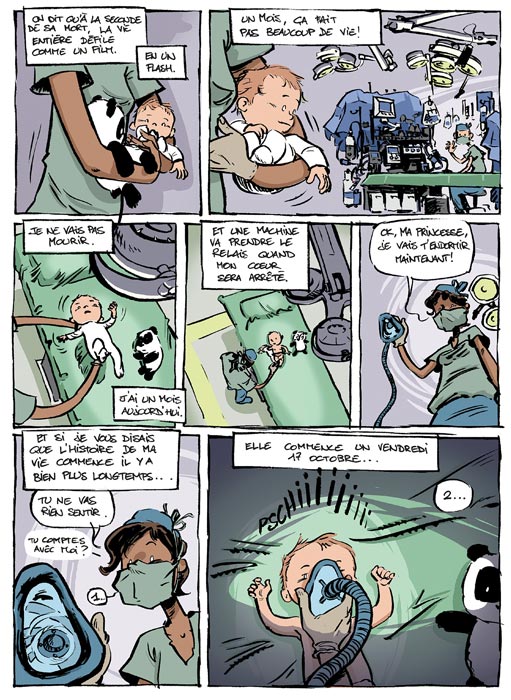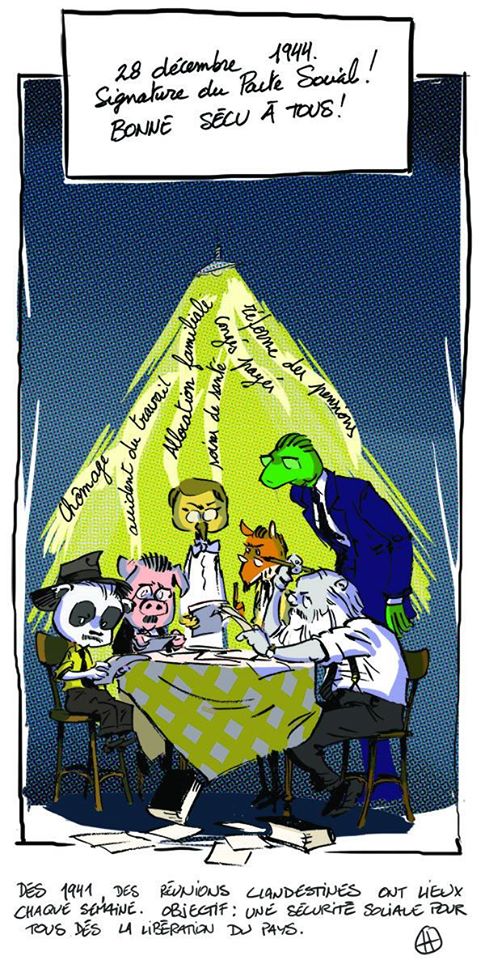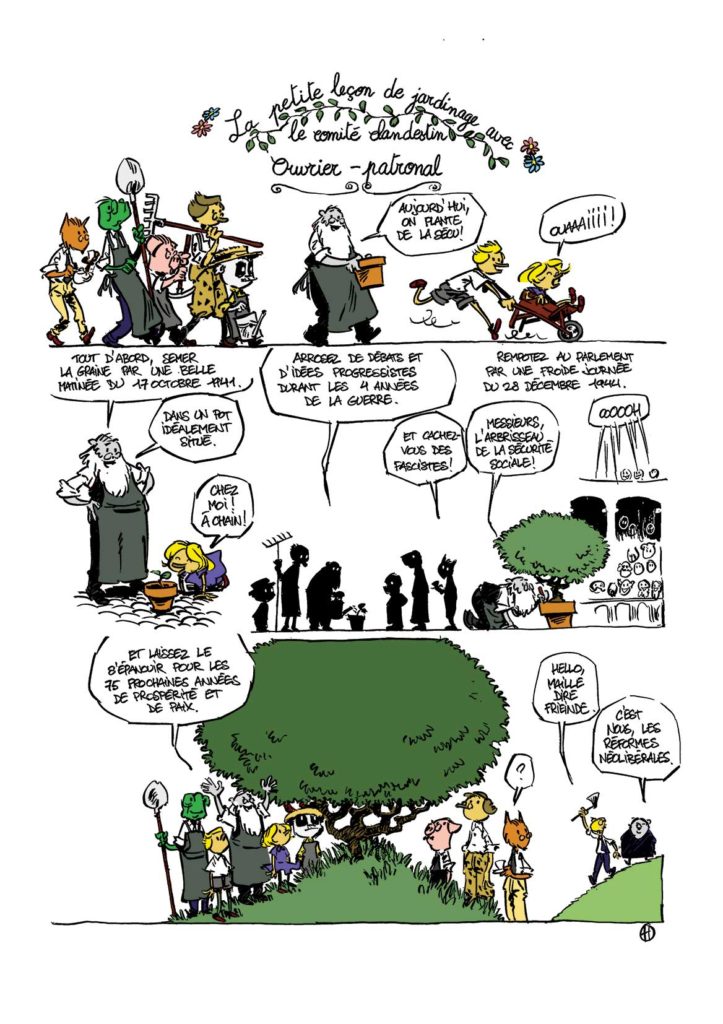INTERVIEW | Jonas Jaccard, chargé de plaidoyer pour SOS FAIM. L’ONG a participé au Conseil d’avis demandé par Zakia Khattabi sur l’arrêté royal « Export ban ».
Propos recueillis par Manon THOMAS, Célestin OBAMA, Emerence NAÔMÉ, publié le 28 avril 2023, modifié le 2 mai 2023.

Manon THOMAS : Qu’allez-vous faire si vos revendications ne sont pas entendues par le fédéral ?
Jonas JACCARD : Notre plaidoyer a un objectif : cesser ces exportations de pesticides interdits depuis la Belgique. Le cabinet de la ministre Khattabi avec le SPF Économie ont estimé que tous les produits concernés seraient moins de 5% du volume de la production belge. Nous sommes plutôt dans un plaidoyer de dialogue, de négociations plutôt que de confrontation. On reste assez positifs sur cette négociation. On a déjà un soutien de la part de la société civile, puisqu’on a une pétition avec près de 8000 signatures. Le vote de cette loi en Belgique est hyper important pour que la Commission européenne embraye et fasse une proposition.
M.T. : La loi « EGAlim » est pionnière en France avec ses failles. Quelle serait votre analyse pour améliorer le processus quant à l’export ban en Belgique ?
J.J. : Effectivement, il y a des failles [ndlr : les exportations de substances actives sont autorisées et plus les produits finis] qui ont été observées. Malgré les failles du dispositif en France, on a observé entre 2021 et 2022 que les exportations ont été divisées par 4. Même si le dispositif est défaillant, incomplet, imparfait, en tout cas il fonctionne. L’avantage qu’on a : on a appris de nos erreurs avec la première tentative en France. La ministre de l’Environnement [a pris] en compte ces lacunes et donc du coup l’arrêté royal de la ministre est quand même un peu plus complet à ce niveau-là. Les ONG ont fait un travail disons en « sous-marins », elles ont réussi à glisser dans un article de la loi un arrêt d’exportation, ce qui effectivement fait grand bruit au moment donné où la loi a été votée. Les industriels ont bataillé un peu pour faire annuler cet article en argumentant du chantage à l’emploi, tout comme en Belgique, avec 2500 emplois menacés. Quatre organisations françaises ont déposé plainte ou fait un recours devant [la Haute] autorité pour la transparence pour lobby mensonger. Selon Médiapart, les chiffres avancés aurait été grossis. Après 3 ans de bataille, certains arrêts d’exportation ont quand même été votés [ndlr : la loi a été votée le 1/1/2022] et on verra ce qu’il en est pour ce lobby qui est mensonger.
« Les ONG ont fait un travail disons en « sous-marins », elles ont réussi à glisser dans un article de la loi un arrêt d’exportation [en France], ce qui effectivement fait grand bruit quand la loi a été votée. »
Jonas JACCARD
Célestin OBAMA: Qu’est-ce qui explique la dépendance aux pesticides ?
J.J. : C’est une question complexe entretenue par les firmes agrochimiques en faisant croire que l’agriculture ne peut pas se passer de leurs pesticides. C’est l’inverse, elles sont dépendantes de l’agriculture pour assurer leur profit. C’est la technique des cigarettiers, l’industrie tente de décrédibiliser certains scientifiques pour montrer que les recherches sont biaisées. Elle va essayer de publier des recherches alternatives pour montrer que les pesticides sont nécessaires à cette production agricole.
M.T. : Comment allez-vous aider les pays importateurs « clients » des entreprises belges à trouver des alternatives aux pesticides ?
J.J. : C’est important de souligner qu’on ne fait pas de plaidoyer dans des pays partenaires et importateur. On n’est pas dans une logique de substitution de dire : « Bon bah allez, on va vous expliquez comment vous devez élaborer vos politiques publiques et agricoles ». Nous on fait du plaidoyer à destination de la Belgique par rapport à ce que l’on sait : la Belgique exporte des produits qui ont des dommages collatéraux dans des pays du sud (des morts, des empoisonnements chroniques, etc.). Ce qu’on prévoit de faire, ce sont des renforcements de capacités et de stratégies de plaidoyer déjà élaborées, dans des pays où des organisations ont déjà identifié des problèmes liés à certains pesticides pour arriver, par exemple, à obtenir des compromis de la part de leurs gouvernements locaux. Notre partenaire au Pérou est très actif sur le plaidoyer. Depuis les années nonante, ils travaillent sur la question des pesticides pour demander une meilleure prise en compte des risques liés à l’utilisation des pesticides dans leur pays. Notre plaidoyer n’est pas non plus hors sol, il fait écho aussi à des plaidoyers qui existent déjà dans nos pays partenaires.
M.T. : Quels sont les impacts et comment sont-ils mesurés, de l’exposition aux pesticides sur les populations autochtones ?
J.J. : Tout ce qui est dégâts, c’est quand même difficile à comptabiliser. Au niveau mondial, une étude scientifique de 2020 estime à 385 millions d’intoxications annuelles (de travailleurs agricoles, d’agriculteurs, d’agricultrices, etc.) et 11 000 décès par an liés à l’utilisation des pesticides interdits et non-interdits, dont 99% arrivent dans des pays du Sud [ndlr : étude de BIM Public Health]. Pour les produits qui ont été interdits, c’est pour des raisons cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Ils sont perturbateurs endocriniens et ils causent des dommages irréversibles avec des doses infimes. Cela donne de l’iniquité. Il y a plein d’exemples qui montrent que les compagnies agrochimiques savent très bien les dommages que provoquent leurs produits […]. Dans le cas du paraquat, un pesticide créé dans les années 50 et qui est utilisé depuis les années 70. Il y a des « Syngenta leaks », des lanceurs d’alertes qui ont lancé sur la gravité de ce produit qui est mortel et la firme l’a caché délibérément. C’est vraiment la stratégie des cigarettiers.
M.T. : Quelles sont les alternatives possibles aux pesticides ?
J.J. : Mes connaissances à ce niveau-là vont forcément être ce qu’elles sont, c’est-à-dire celles d’ un mec blanc qui habite dans une capitale et qui ne peut pas parler pour les agriculteurs et les agricultrices. Ce qui est sûr c’est qu’il y a des alternatives qui existent. Avec nos partenaires avec lesquels on travaille, ils mettent en place des projets et des techniques, par exemple, liées à l’agroécologie. Ce sont plus que des techniques agricoles, c’est tout un concept, je dirais, un mode de vie, une nouvelle façon de concevoir les relations, les échanges marchands, etc. Le problème est l’iniquité des financements entre des multinationales de l’agrochimie par exemple, et des petits producteurs. Ces alternatives-là, elles existent mais il faut juste un peu plus les promouvoir.
M.T. : Que répondez-vous au discours qui dit que « sans preuve de nocivité des produits, il n’y a aucun danger » ?
J.J : Les industries en connaissent la toxicité parce qu’ils sont enregistrés et évalués par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. L’industrie joue sur certaines ambiguïtés. Celle entre danger et risque. L’un est les caractéristiques physico-chimiques de la molécule et l’autre, est le facteur d’exposition. Quand on dialogue avec l’industrie, elle va dire : « Ils ne se protègent pas assez et c’est pour ça qu’ils ont des risques liés aux pesticides ». L’entreprise ne prend pas sa responsabilité liée à la dangerosité du produit, elle la remet sur l’agriculteur.
« L’industrie joue sur certaines ambiguïtés, c’est entre danger et risque »
Jonas JACCARD
M.T. : Dans la loi européenne, les pays exportateurs sont censés accompagner les pays importateurs dans l’utilisation de leurs produits. Vous dites que ça ne se fait pas en réalité ?
J.J. : Dans la convention de Rotterdam, il est stipulé qu’il y a effectivement des notifications pour les exportations, donc le pays importateur doit donner son autorisation […] c’est-à-dire que théoriquement le pays a le droit de dire non. La convention est censée favoriser l’échange d’informations auprès des produits qui sont considérés comme dangereux. […] Les pays exportateurs, souvent les plus riches sont censé donner une aide et un appui financier pour favoriser le réseau d’informations et que le choix d’importer un produit soit fait en pleine conscience. Sur le terrain, il y a quand même un grave manque de ressources humaines dans des pays comme la République Démocratique du Congo, par exemple, où il y a deux-trois personnes dans le pays pour gérer l’ensemble des dossiers de demande d’importations de plusieurs centaines de pages. Des dossiers extrêmement compliqués qui ne sont pas forcément dans leur langue maternelle. Il y a vraiment une iniquité dans ce processus.
C.O : Comment les lobbys s’impliquent-ils au quotidien ?
J.J. : Dans la vraie vie, Syngenta est en compétition avec Bayer pour s’assurer des marchés. A Bruxelles, elles sont amies et regroupées sous des lobbys. En Belgique et au Luxembourg, ce sont Belplant et Essencia qui défendent de concert les intérêts des firmes agrochimiques […]. Pour cet arrêté royal, SOS FAIM a participé à un conseil d’avis, l’industrie était là pour faire valoir ses intérêts et défendre bec et ongles ce en quoi ils croient.
C.O, : Ne défendez-vous pas vos intérêts pour avoir du financement ?
J.J. : Si on fait du travail de plaidoyer pour avoir plus de financement ? Absolument pas [rires]. Pour cet arrêté royal, on travaille avec la ministre de l’Environnement et un peu avec le ministre de l’Agriculture, aucun n’est notre ministre de tutelle. Par contre, nous faisons aussi valoir nos intérêts auprès de processus décisionnels. A la une nuance majeure et subtile qu’eux font du lobbying pour des intérêts privés, nous faisons du plaidoyer pour des intérêts de la société civile. Nous sommes rémunérés par de l’argent public.
M.T. : Avez-vous encore quelque chose à rajouter ?
J.J. : Cela pose juste question avec notre rapport à ça et les dégâts des pesticides sur l’environnement sont connus, reconnus en disant qu’il y a un consensus scientifique. Je trouve ça quand même assez déplorable qu’on en soit encore à batailler pour quelques petits produits alors qu’en fait il faudrait accélérer à vitesse grand V pour répondre aux enjeux dérogeant à la biodiversité.◘